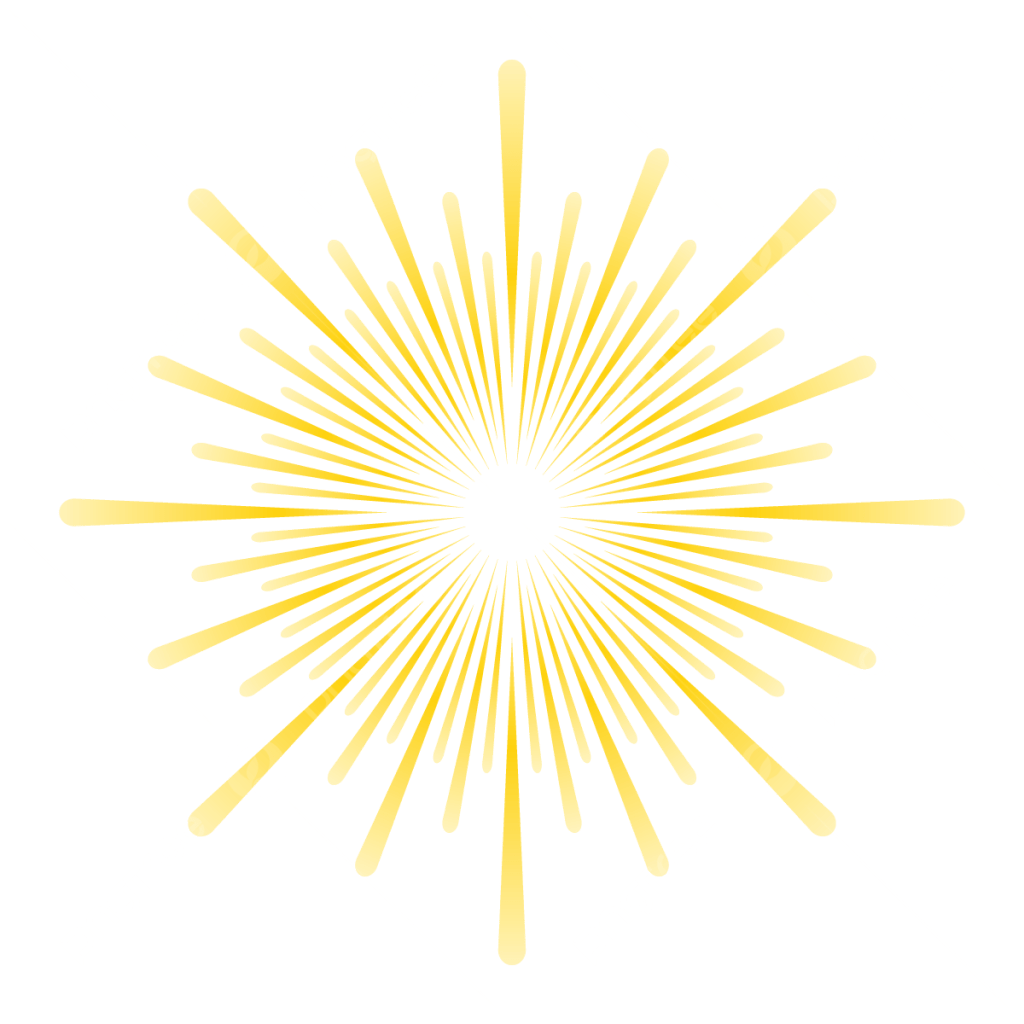Mario Kart World est un excellent volet de la série. Je commence à ne pas être trop mauvais, et régulièrement, je me vois, cheveux au vent (je joue la Princesse Peach uniquement pour ça), en première position, prenant parfaitement les virages et les raccourcis. Enfin jusqu’à ce qu’une carapace rouge, bleue ou dorée vienne me stopper dans mon élan et me faire perdre mon avance. C’est même pas juste, je conduisais tout bien comme il fallait.
Cette frustration a le même goût que mes cours en ce moment. Je sors de ce vendredi avec une pêche d’enfer et la musique de victoire de Mario Kart dans les oreilles. Toutes mes classes ont bossé, les élèves avaient leur matériel, étaient prêts, ont accepté de se concentrer même quand c’était compliqué… Je suis le meilleur, je suis le prof de l’année !
Je le suis aujourd’hui.
Parce qu’il n’y avait pas la carapace rouge de deux mômes se castagnant dans les couloirs juste avant d’entrer en français. Parce qu’Aniel est en mesure conservatoire avant son conseil de discipline, Aniel que je n’ai absolument pas pu aider. Pas de peau de banane d’intervention de la vie scolaire, devant interrompre mon cours, parce que quelque chose de grave s’est passée l’heure précédente.
Je suis le meilleur prof du monde parce qu’il n’y avait pas d’obstacles, pas d’aléatoire, pas d’imprévisible, je ne jouais pas selon les règles habituelles. Toute honte bue, c’est pas que le reste du temps, nous soyions mauvais, nous les personnels d’éducation : c’est qu’un obstacle qu’on avait absolument pas vu venir peut nous faire passer de la première à la vingtième place en une fraction de seconde. Et que comme dans Mario Kart, il n’y a pas le temps de se lamenter ou de rager. Il faut continuer à avancer en espérant qu’on va trouver le bonus caché qui nous permettra de refaire course, peut-être pas en tête, mais suffisamment haut pour être qualifiés pour la journée suivante.