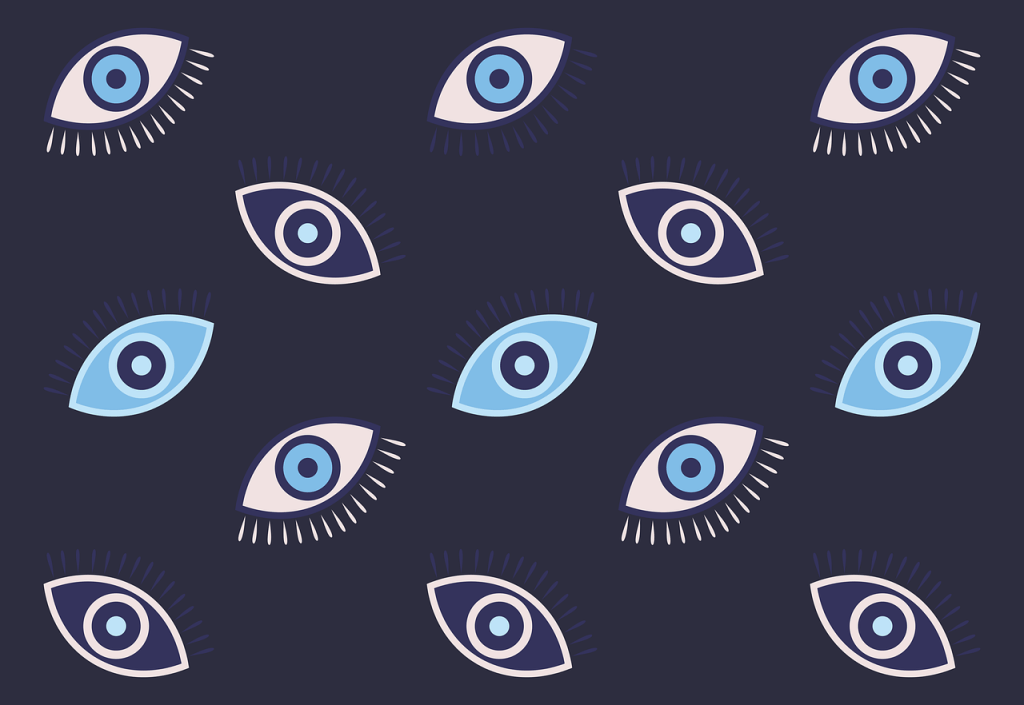Ils ont compris, et ont l’élégance de ne jamais le montrer. Trois élèves de première, une fille, deux garçons. Après quelques mois, ils ont pigé que je suis le prof qu’il leur faut. Ils comprennent immédiatement où je veux en venir dans mes cours. Le chemin de ma pensée leur est sans obstacle, et nous avons les mêmes références, qu’elles appartiennent à la classe ou au dehors. Souvent, lors des cinq minutes de pause, entre deux heures, ils s’approchent. Me sortent une ou deux blagues ultra obscures pour le profane. Mais ne vont pas plus loin. Dès la deuxième sonnerie, ils retournent à leur place, bossent, comme n’importe quel autre élève.
Mais ça n’est pas qu’une histoire de complicité cachée. Cette année, leurs résultats dépassent toutes les attentes. Les leurs – ils n’ont jamais été des brutes en français – les miennes, et celles des collègues qui ont corrigé leurs copies anonymes de bac blanc. Leurs résultats étaient tellement bons que nous avons tous les quatre cligné des yeux.
C’est un privilège très injuste, très miraculeux : nous nous convenons. Même si, depuis que j’ai eu la chance de croiser Monsieur Vivi, donner à chacun sa place, son rôle dans la classe est ma préoccupation majeure, il arrive que certains se sentent mieux que d’autres. Ça n’est pas grave. Et, je l’avoue sans rougir, cela me fait du bien, quand je croise leur regard serein, de les savoir là, en face de moi.