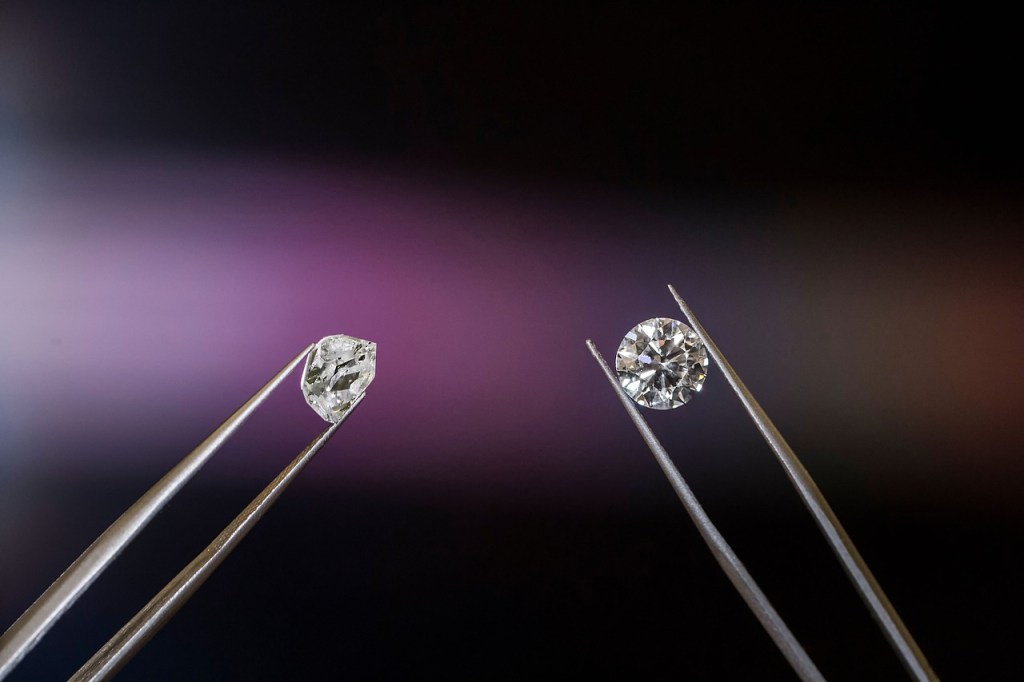Quand j’ai commencé ma carrière de prof, je ne savais pas qui j’étais.
J’avais un tel désir d’être accepté, aimé, ou à tout le moins toléré dans n’importe quel groupe humain que j’étais incapable d’envisager la moindre situation conflictuelle. Je pense – je me trompe sans doute – ne pas être le seul dans ce cas, loin de là.
Et c’est probablement ce qui a expliqué la catastrophe absolu de mes trois premières années d’enseignement : en plus de ne pas avoir été formé, j’étais incapable de tracer des lignes claires pour mes élèves : quel était ce cours, quels étaient mes attendus, mes lignes rouges, mes zones grises ?
Les mômes, étant des mômes, l’ont senti immédiatement. Et ces trois années ont été une destruction en règle de mon ethos de prof. Ou plutôt de ce que je croyais l’être. Tout a été remis en jeu. Mon attitude, ma façon de faire cours, de parler, mon rapport aux devoirs, aux sanctions. Rien n’était solide, tout a été démoli. Et ça n’a pas été agréable. Du tout.
Cette façon d’entrer dans l’enseignement n’a pas à être la seule, loin de là et heureusement.
Mais il y a maintenant, au cœur de ma persona d’enseignant, quelque chose d’infiniment plus solide. Qui s’est forgé lorsque j’ai été obligé d’arrêter d’avoir peur. Lorsque j’ai dû lâcher toutes mes conceptions de l’enseignement, de la didactique, de la pédagogie et de l’autorité parce que rien n’avait fonctionné. Quand j’ai été obligé de tout créer.
Ce qui me sert désormais à enseigner est composite. Un ensemble de savoirs et de connaissances dans lequel se reflète les regards de dizaines de collègues aidants, de milliers d’élèves. Et c’est sans doute ce qui est le plus solide, non seulement dans ma pratique d’enseignant, mais dans mon expérience d’être humain.